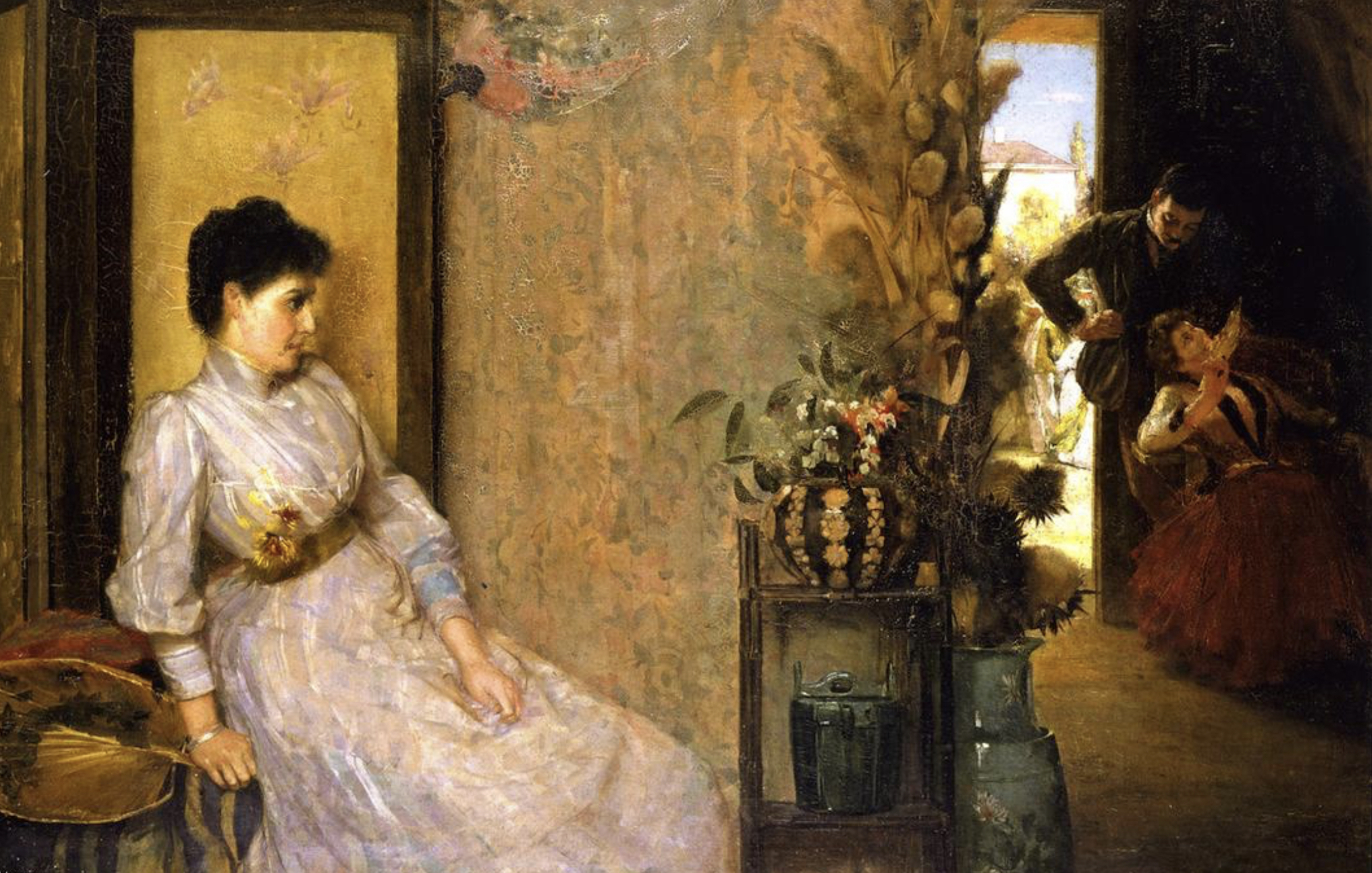21 Oct RÉSEAUX (9)
Ces crises qui me saisissent dès que la technologie me résiste, Charles les observe avec un mélange de perplexité, d’effroi et d’hilarité contenue. L’autre jour, il s’agissait de mon code d’accès ITunes, que je n’arrivais pas à retrouver et pour cause – puisqu’on s’obstine à vous demander une majuscule, une minuscule, un caractère spécial, etc. Ce qui rend rigoureusement impossible le fait de mémoriser ce foutu code. C’est le constat que je fais auprès de Charles, tout en m’emportant contre la machine comme si elle m’en voulait personnellement. Je prends, dans ces moments, un ton que je ne saurais définir, fait à la fois d’insistance, de ralenti, de rage prête à exploser. Il garde un calme olympien, m’invente patiemment un nouveau code, et me l’envoie par mail (pour ne pas l’oublier). Cette opération effectuée, on s’aperçoit que je ne risquais pas d’accéder aux films En location, puisque j’ai cliqué sur Non visionnés. Il ne fait pas de commentaire.
Cette scène se reproduit régulièrement. Hier, c’était ma page fiscale que je n’arrivais pas à ouvrir. Normalement, le code s’affiche tout seul. Cette fois, rien n’apparaît. Il faut, pour réinitialiser, former des lettres identiques à celles qui s’affichent. J’essaie une fois, deux fois, trois fois. Toujours le même message d’erreur. Ma frappe sur le clavier, d’abord désinvolte, passe à la frénésie, ou à la minutie torturée. Charles répond à mon appel, qui se fait feutré pour ne pas le crisper. Il est bien obligé de prendre acte que cela ne marche pas. Il ne dit pas “C’est très étrange” (ce gimmick chez lui que je me plais à imiter, et qui traduit sa rationalité imperturbable, face à tout ce qui déborde). Il le pense fortement. Tombé dans les ténèbres, le code revient tout seul s’afficher dans sa case. Charles me jette un regard ironique.
On parle, un peu plus tard, de la violence qui m’envahit dans ces instants. Je lui explique qu’elle vient de la peur, une peur panique d’être bloqué. Cette formule semble le frapper. Un ou deux jours après il m’en reparle. Il me compare à certain ami qui, dans la période folle que nous traversons, se laisse glisser dans la dépression. L’ami en question lui a même déclaré qu’il était choquant, par les temps qui courent, de dire qu’on va bien. “Toi, me dit-il en substance, c’est le contraire. Ta peur d’être bloqué est ton moteur.”