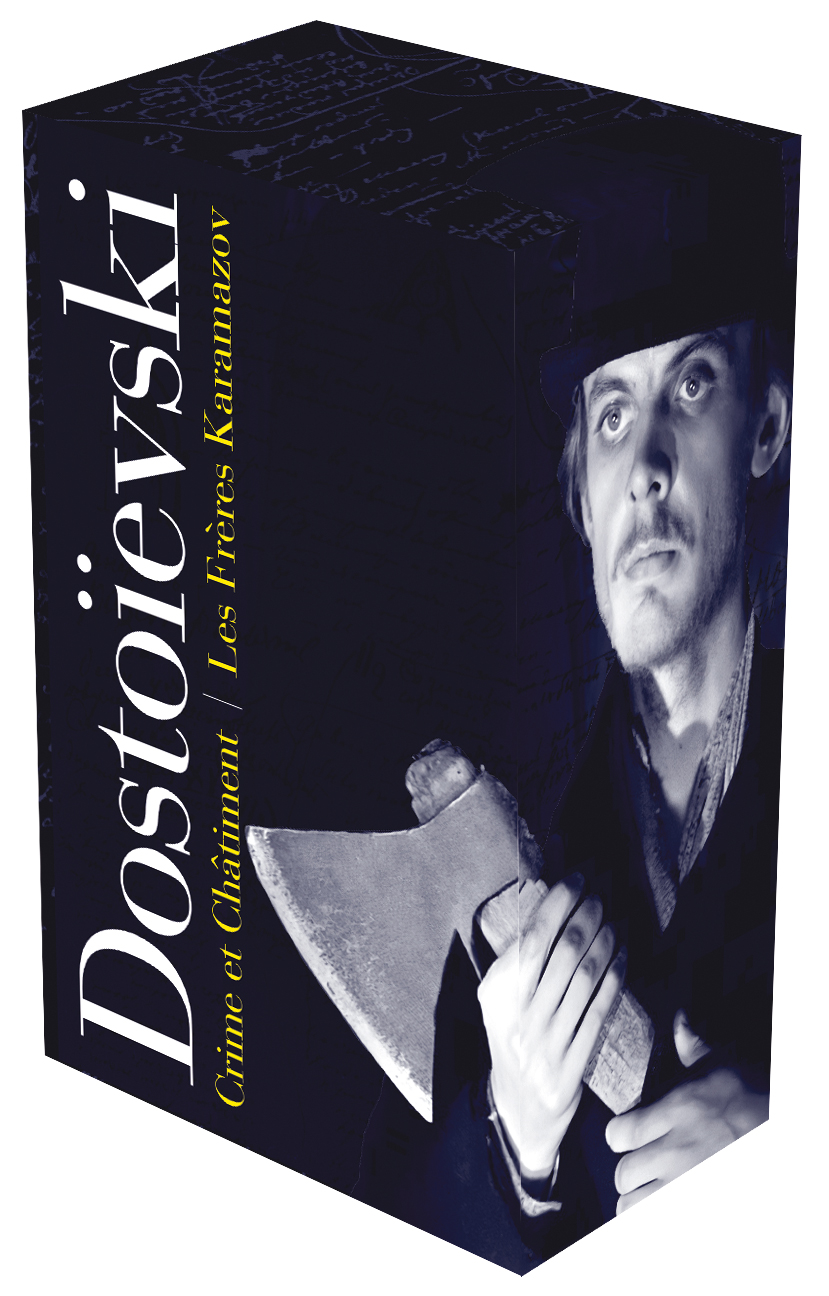11 Avr REVES (3)
Je fais des rêves mondains, où le cinéma tient une certaine place. L’autre nuit, je conseillais le programmateur de la Cinémathèque française, qui s’évertuait à trouver de nouvelles idées. Pourquoi pas un hommage à Laurence Olivier ?, lui disais-je, et je lui faisais valoir ses trois films tirés de Shakespeare. Ainsi que son pedigree d’acteur de cinéma : Le Prince et la Danseuse, Les Hauts de Hurlevent… A ce dernier titre, mon interlocuteur faisait la grimace.
Cette nuit, je me suis retrouvé dans un colloque de cinéma où se pressaient les people. Alors que j’attendais de passer mon tour, mes quelques notes à la main, Chiara Mastroianni venait me saluer, me demandant si j’étais un ami d’Arthur Dreyfus (j’apprendrais plus tard qu’il l’avait informée de ma présence). Elle me prodiguait de singulières gentillesses.
Cela n’en finissait pas, les orateurs succédaient aux orateurs, et mon tour ne venait jamais. Errant aux abords de la salle de conférences, j’apercevais, de loin, X…, bien forcé de me claquer la bise. Nous échangions deux ou trois mots convenus, je n’osais solliciter ses impressions sur mon dernier envoi livresque. Il jetait son dévolu sur un(e) adolescent(e), qui traînait dans les parages. J’avais oublié de lui parler de son dernier film.
A présent, l’attention publique se focalisait sur un acteur à peine connu : le jeune Pakistanais de la série The Night of, découverte ces soirs-ci. Il était plus beau qu’il n’est en vérité, répondant aux questions indiscrètes d’une assistance avide de potins. Je prenais la parole, sans y être invité : “On se croirait dans Lola Montès.” Je revoyais les lustres qui montent et descendent, j’entendais les cris de la foule, et tout le Barnum médiatique mis en scène par Ophuls. On se tournait vers moi, sans comprendre à quoi je faisais allusion.
Il y avait de moins en moins de monde. Y… entamait avec moi une conversation joviale, avant de s’éclipser. On se trouvait, maintenant, dans l’ancienne Cinémathèque de Chaillot, avec ses espèces de parpaings troués, tenant lieu de décoration murale. J’hésitais à m’en aller, moi aussi. Après tout, je n’avais pas préparé grand chose, et je risquais d’être pris en défaut. Je me demandais si Y… était encore là, en haut, et si les mondanités allaient continuer.